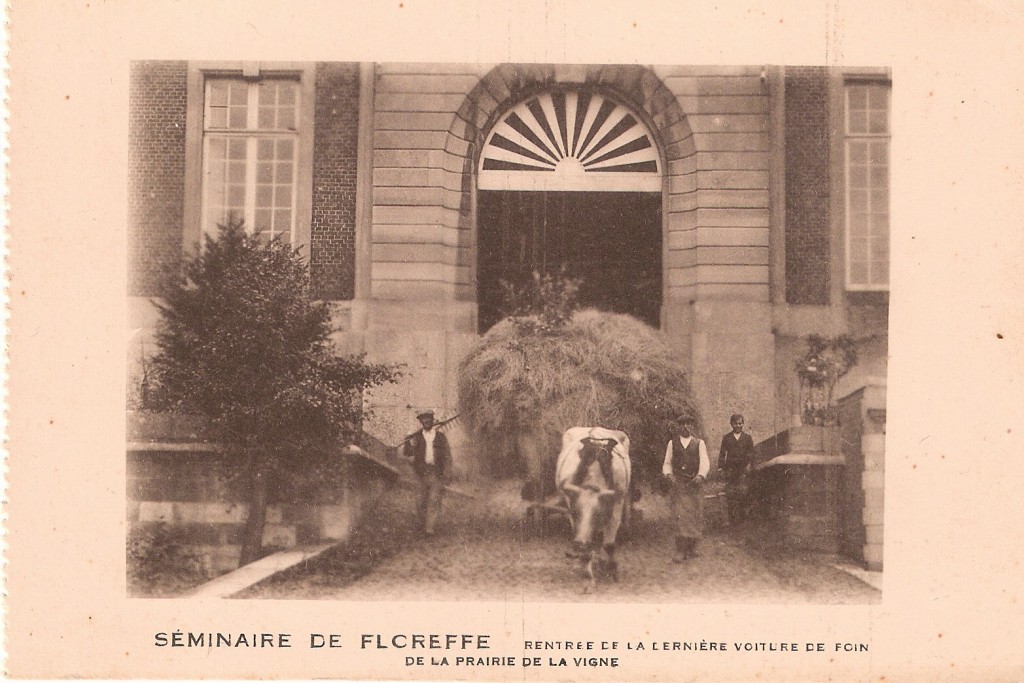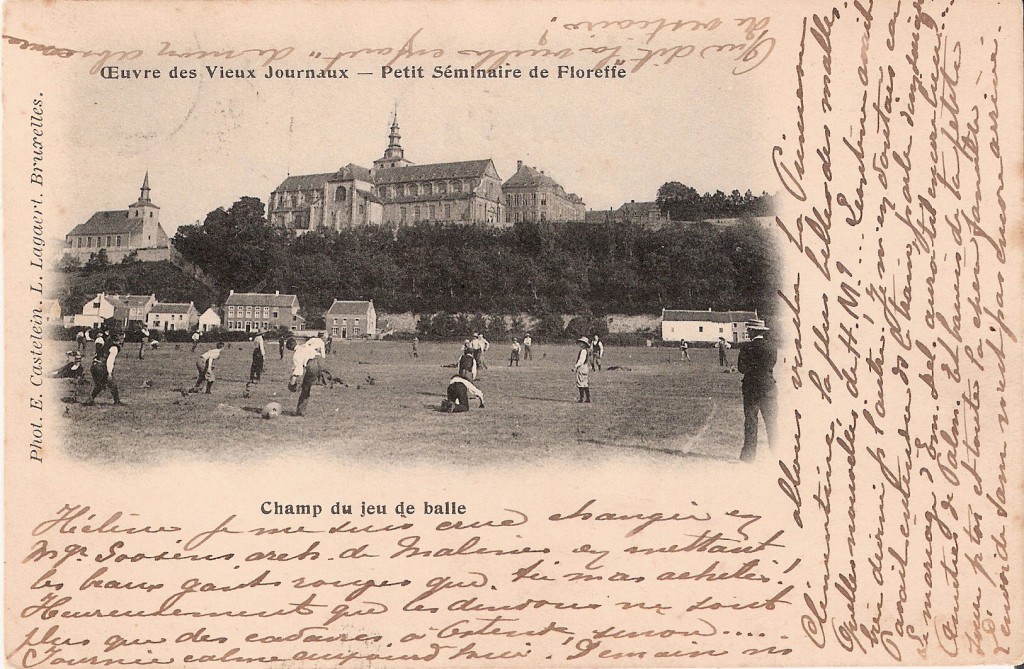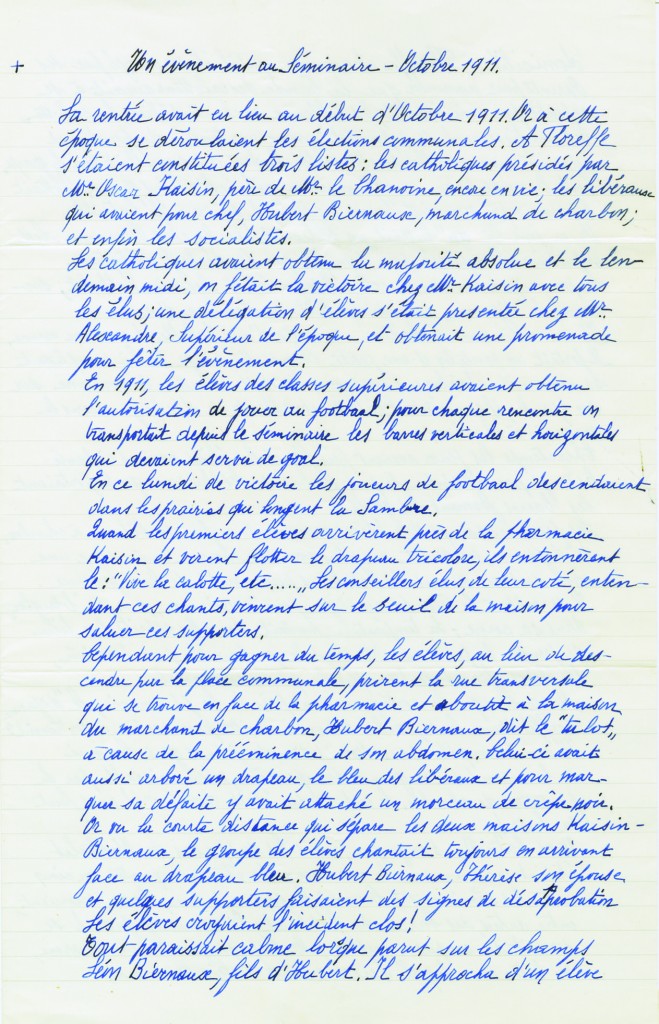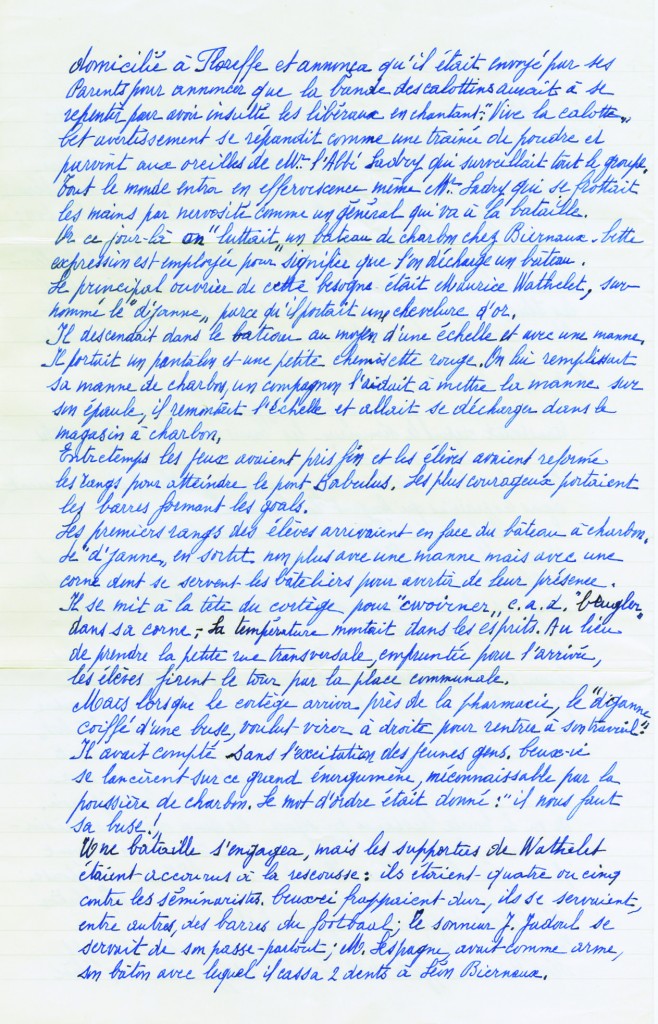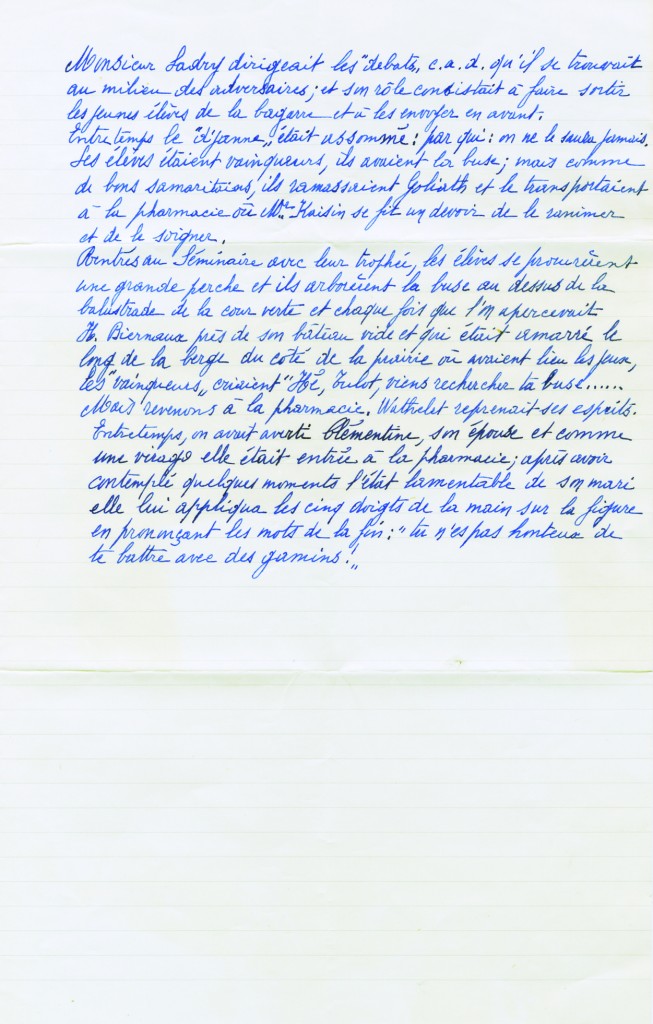Un peu d’histoire
Comme dans toutes les abbayes, la salle du chapitre était l’endroit où les religieux se réunissaient pour délibérer. Son nom lui vient du fait qu’on y lisait quotidiennement un chapitre de la règle de vie. C’est là que se prenaient les décisions concernant l’ensemble de la communauté, parmi lesquelles l’élection du père abbé. Le mot « chapitre » désigne aussi la communauté de chanoines – à Floreffe, des chanoines prémontrés. Ne dit-on pas encore aujourd’hui avoir voix au chapitre pour signifier qu’on a le droit à la parole ?
La photo est un cliché de l’IRPA (Institut Royal du Patrimoine Artistique), n° 5025 B. On distingue nettement les deux époques de construction.
À l’avant-plan, une colonne toscane. C’est le même type de colonne que dans le réfectoire, le même type de voûte aussi, datant du XVIIème siècle.
À l’arrière, deux colonnes et, tout au fond, des étagères. Les deux colonnes sont beaucoup plus basses, elles supportent des voûtes romanes d’arêtes. Ce niveau correspond à l’ancienne voûte qui couvrait à l’origine toute la salle du chapitre, au XIIIème siècle.
Voilà l’explication des deux niveaux : les colonnes plus courtes sont à moitié enterrées, puisque le niveau a été relevé au XVIIème siècle.
Lampes et lampiste
La photo montre l’aménagement qui existait encore au début du XXème siècle.
L’éclairage est assuré par des lampes à pétrole, de la famille des quinquets (qu’on appelait des « lampes belges »). On en distingue deux sur le cliché. Il fallait donc les alimenter en pétrole ; nettoyer les verres ; régler les mèches ; allumer et éteindre. Vu la hauteur, une escabelle était nécessaire.
Toutes ces opérations étaient effectuées par un « lampiste »… qui était tout, sauf un personnage secondaire ! Au Séminaire, cette tâche était remplie par Joseph Franquet, appelé familièrement « Arthur ». Ce fidèle domestique est resté dans la maison de 1897 à 1952. En 1947, il fut fêté pour ses 50 ans de présence au Séminaire. D’abord lampiste, à 18 ans, il devint portier quand l’électricité remplaça le pétrole. Il était un personnage bien connu et apprécié des anciens et des élèves.
Lavoir
Au début du XXème siècle, la salle du chapitre présente l’aspect d’un lavoir.
C’est ici que, une fois levés, les élèves descendaient pour se laver.
L’eau arrivait dans deux réservoirs cylindriques, elle s’écoulait par des robinets dans des bacs, soutenus par des pieds en fonte.
Les élèves se trouvaient de part et d’autre des séries de quatre robinets. En zoomant, on peut voir un mince filet d’eau qui coule de certains robinets, laissant des taches sombres dans les bacs. C’est particulièrement visible dans le bac de droite, où l’eau laisse un dépôt important dans le fond.
Dans le sol actuel, on voit encore la trace des points de fixation des supports en fonte, ainsi qu’une dépression qui permettait de recueillir les eaux en excès.
Quand a fonctionné cette installation ?
Les supports en fonte font penser aux supports des bancs des études, réalisés en 1887.
L’éclairage électrique de tout l’établissement a été entrepris en 1902 et s’est généralisé progressivement. Ici, sur le cliché, il n’est pas encore question d’ampoules électriques. On peut donc raisonnablement dater cette photo entre 1880 et 1910.
Lorsque les lavoirs ont été supprimés, on a placé des bassins en tôle émaillée dans les alcôves.